Le coeur en bandoulière de Josiane Asmane
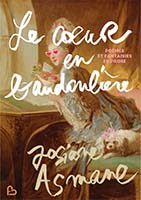 Le
Cœur en bandoulière est un superbe recueil de poèmes courts portés par la fantaisie et illustrés merveilleusement par l’auteure.
Le
Cœur en bandoulière est un superbe recueil de poèmes courts portés par la fantaisie et illustrés merveilleusement par l’auteure.
Il explore la beauté de la poésie, l’amour, la vie et l’importance de prendre son temps, de réfléchir dans ce monde en perpétuels mouvements.
Nous avons eu la chance d'écouter Josiane lors d’une soirée poétique.
Quelle émotion de l’entendre ! C’est un véritable exploit que de dévoiler son coeur, se livrer, s’ouvrir, communiquer son ressenti. Elle transforme les sentiments les plus intimes en musique de mots.
Sa plume est magique. Ses vers courts tissent des images éblouissantes.
Ils sont à la fois tendres et puissants.
Un livre qui rend la poésie accessible à tous. On découvre rapidement ses bienfaits. Ses poèmes sont à consommer sans modération ! Certaines poésies peuvent être scannées pour être lues et entendues sur Pinterest. On plonge alors dans un univers poétique et graphique.
Laissez ce recueil sur votre table de nuit et pendant les tristes soirs de l’hiver monotone, ouvrez-le à n'importe quelle page et vous serez transportés par cette voix poétique unique d’une extrême délicatesse.
Ses poèmes laissent une belle trace dans le cœur de ceux qui les lisent. C'est un livre qui
invite à la contemplation et à la rêverie. Il ne reste cependant pas hermétique : on y décèle également des “cris contre le racisme et la guerre” et une volonté de dialogue.
Bravo, chère poétesse de la place de la République et continuez à nous émerveiller.
Le Cœur en bandoulière de Josiane Asmane - Les Bonnes feuilles - 232 p. - 22 €.
Jacky Morelle (13/11/2025)
Josiane Asmane est auteure, poétesse et bouquiniste. Elle est connue pour ses ateliers, conférences et lectures en entreprise et dans des institutions culturelles. Très généreuse, elle organise avec d’autres bénévoles des maraudes poétiques deux mercredis par mois. Tous les sans- abris de la place de la République la connaissent et l'attendent. Une partie de ses droits d’auteur est reversée à son association “la poésie ça sauve la vie.”. Elle intervient dans les prisons, les Ehpad et pour les personnes malvoyantes. Une jeune femme philanthrope et pleine d’énergie.
 Comme
il est écrit sur la quatrième de couverture: “C’est en
effectuant des recherches sur le célèbre couturier que la
journaliste Justine Picardie découvre par hasard le passé
historique de la sœur de ce dernier”. Mais que sait-on de
Catherine Dior ? /p>
Comme
il est écrit sur la quatrième de couverture: “C’est en
effectuant des recherches sur le célèbre couturier que la
journaliste Justine Picardie découvre par hasard le passé
historique de la sœur de ce dernier”. Mais que sait-on de
Catherine Dior ? /p>
AGinette, dite Catherine, est née à Granville (Manche) le 2
août 1917 dans une famille bourgeoise et aisée. Elle était
la dernière d’une fratrie de 5 enfants. En mai 1931, leur
mère meurt à 52 ans.
La même année, son père Maurice Dior (1872-1946), industriel
normand, est ruiné à la suite de la crise de 1929. Ils
quittent leur appartement parisien et s’installent à Callian
dans le département du Var.
Catherine est la sœur chérie de Christian. Il a douze ans de
plus qu'elle mais ils partagent le même amour pour l’art, la
musique et les fleurs.
Fin 1941, Christian s’installe avec sa sœur rue Royale. Il
quitte la Provence lorsque son ancien employeur lui propose
de le réembaucher.
Catherine entre peu de temps après dans la Résistance.
Partisane de De Gaulle, elle détestait Pétain, Pierre Laval
et le régime de Vichy. Le premier acte de résistance
commence pour elle en 1941. Elle va chercher une radio pour
écouter le Général De Gaulle sur les ondes de la BBC. Le
seul fait d'écouter De Gaulle vous faisait emprisonner. Elle
tombe aussitôt follement amoureuse de celui qui va lui en
fournir une. Il s'appelle Hervé des Charbonneries, grand,
séduisant, il est marié et père de trois enfants. De vendeur
de radio, il est devenu héros de la résistance quelques mois
après sa rencontre avec Catherine. Elle est séduite et
s’engage à son tour. Il l'a recrutée dans son réseau F2
franco - polonais qui fournissait des renseignements aux
services britanniques à Londres. Son rôle est celui d'une
coursière. Elle collecte et transmet des informations sur
les mouvements des troupes allemandes, ce qui nécessite de
longs trajets à bicyclette, une mission très dangereuse.
Pendant deux ans, elle utilise l’appartement de son frère,
rue Royale pour recevoir les membres de son réseau. Hervé
des Charbonneries a douze ans de plus qu'elle et a étudié à
Sciences Po avec Christian Dior. Ils ne se sont jamais
mariés, mais sont restés ensemble jusqu'à la mort d’Hervé.
Le 6 juillet 1944, à 16 h 30, elle est arrêtée place du
Trocadéro par quatre hommes armés. et conduite au 180 rue de
la Pompe, l’antichambre de l’enfer. Tous les psychopathes
nazis y sévissent. Les criminels de la rue de la Pompe ont
manifesté une cruauté monstrueuse. Catherine est soumise à
un interrogatoire accompagné de brutalités inhumaines :
coups de poings, coups de pieds, griffes…tortures violentes
dans la baignoire. Elle subit les pires atrocités. Elle ne
dira rien protégeant son frère et ceux qu'il cache dans
l’appartement. On ne peut qu’être admiratif devant la force
de caractère de cette femme discrète.
Le 22 août 1944, elle est déportée au camp de Ravensbrück
avec tant d’autres prisonnières politiques. Les détenues
sont soumises au travail forcé dans des conditions
inhumaines. Malgré la peur constante des gardes et de leurs
chiens, ces femmes courageuses ne renoncent pas à subvertir
les règles du camp. La solidarité a permis à beaucoup
d’entre elles de supporter les mauvais traitements et de
survivre grâce à l'amitié dans le camp de Ravensbrück. Pour
résister à la déshumanisation, les détenues mettent en place
des réseaux de solidarité complexes, fragiles, éphémères
mais absolument nécessaires à la survie.
Durant ces mois d'absence, son frère remue ciel et terre
pour la retrouver. Extrait des mémoires de Christian Dior :
“ Je me demande parfois comment j’ai réussi à
continuer….pour ma sœur, avec qui je partageais les joies du
jardinage à Callian, qui a été arrêtée puis déportée. J’ai
tout essayé pour la retrouver, en vain. Le travail, un
travail exigeant et absorbant, était la seule drogue qui me
permettait de l’oublier “.
En 1945, après la longue marche de la mort, elle retrouve son frère et son amoureux Hervé des Charbonneries. A son arrivée à la gare, son frère ne la reconnaît pas tout de suite. Son corps décharné, le dos courbé, le visage émacié et diaphane, elle est méconnaissable. Extrêmement affaiblie, elle retourne habiter chez son frère. C’est en hommage à sa sœur que le couturier appelle son premier parfum Miss Dior après avoir entendu son amie, l’avant-gardiste Mitzah Bricard s’exclamer en voyant Catherine “ Tiens, voilà Miss Dior !”. Il lui dédia également la magnifique robe brodée de fleurs Miss Dior. Elle a reçu certaines des décorations nationales les plus prestigieuses : la Légion d’honneur, la Croix de guerre 1939-45 avec étoile vermeille et la Croix du combattant en France ; la Croix de la Vaillance polonaise ; la King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom attribuée par les autorités britanniques ; la médaille de la Résistance française. Sa citation pour la Croix de guerre en 1945 rapporte que lors des missions périlleuses, elle a su faire preuve de “ sang froid, de décision et de prudence.”
Puis, avec son compagnon, ils partent à Callian pour qu’elle reprenne des forces. Elle s’adonne à plein temps à l’horticulture. Ses roses sont utilisées pour le parfum Miss Dior . Elle aime ces champs de fleurs qui s'exhalent dans les parfums du grand couturier. Catherine et Hervé des Charbonneries ont tenu également un stand de fleurs aux Halles, rue Jean -Jacques Rousseau. Elle possède une exploitation de près de 2 hectares de roses à parfum.
C’est là - bas qu’elle apprend le décès de son frère en
1957. Toutes les fleurs des funérailles de Christian Dior
ont été déposées sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe à Paris à la demande de Catherine. Elle mettra
un point d’honneur à faire vivre son héritage, notamment au
travers de la villa de Granville, transformée en musée Dior.
Elle meurt le 17 juin 2008 à plus de 90 ans et est inhumée à
Callian près de son frère.
En 2019, la directrice artistique de Dior, Maria Grazia
Chiuri, lui consacre toute une collection Elle veut y mettre
“ l’élégance de Christian, l’attitude de Catherine “.
L’escalier à pic qui monte au jardin à Granville porte
désormais le nom de Catherine Dior. Était - elle féministe ?
On peut lui attribuer cet adjectif par certains côtés de sa
personnalité : Elle n’a jamais épousé Hervé. En cédant à
l'amour pour un homme marié, elle s'oppose aux principes de
son éducation catholique. Elle possédait sa propre
entreprise. Elle était indépendante financièrement. Elle
croyait dans le droit des personnes à voter, à contrôler
leur propre système politique. Le livre de Justine Picardie
est passionnant, richement documenté et magnifiquement
illustré. Les mondes de la mode ne sont pas oubliés.
Elle retrace le destin des Françaises qui résistèrent au péril de leur vie. Elle nous offre aussi une plongée vertigineuse dans le milieu de la mode sous l’Occupation et la Collaboration. C’est une très bonne analyse politique du siècle passé. Bien sûr Justine Picardie n’oublie pas son premier sujet de recherche : Christian Dior. Elle nous parle longuement du grand couturier, de la mode mais aussi de tout ce qu’il a entrepris pour sauver sa sœur de la déportation. Elle relate les procès des collaborateurs, des nazis. C’est un livre bouleversant, un hommage à toutes les femmes connues ou inconnues qui se sont battues pour que nous vivions. Pour préparer son livre, Justine Picardie s’est rendue deux fois à Ravensbrück.
Les femmes ont joué un rôle important dans la résistance mais leur place a été reconnue tardivement. Leur engagement a été peu valorisé à la Libération Peu de femmes exercèrent des fonctions dirigeantes dans la Résistance à l'exception de Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau Alliance et Lucie Aubrac, membre du cercle des dirigeants de Libération - sud. L'entrée au Panthéon de Germaine Tillion et de Geneviève De Gaulle en 2015, de Joséphine Baker en 2021 peut être considérée comme une reconnaissance tardive des femmes dans la Résistance. Simone Veil a également été panthéonisée en 2018. Catherine Dior y aurait eu sa place. Ne les oublions pas.
Miss Dior - Justine Picardie -
Éditions Flammarion - 416 p.
Broché : 23,90 € - Poche : 12 €
Jacky Morelle (07/03/2025)
La disparition du vivant et moi - Comprendre pour changer de Hélène Grosbois
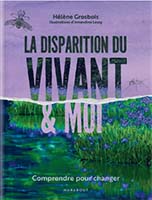 L’autrice Hélène Grosbois est une jeune femme très brillante. Ex-cadre de haut niveau dans la finance, elle a quitté la ville au rythme éreintant pour s’installer en Bourgogne et vivre en autonomie alimentaire, en accord avec ses idées. Depuis sa plus jeune enfance, elle a toujours été sensible aux sujets environnementaux.
L’autrice Hélène Grosbois est une jeune femme très brillante. Ex-cadre de haut niveau dans la finance, elle a quitté la ville au rythme éreintant pour s’installer en Bourgogne et vivre en autonomie alimentaire, en accord avec ses idées. Depuis sa plus jeune enfance, elle a toujours été sensible aux sujets environnementaux.
Après l’obtention d’un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole, elle se lance dans la culture sans pesticides de divers légumes. Pour l’aider, elle accueille des bénévoles en échange du gîte et du couvert.
Après avoir gagné beaucoup d’argent qui lui a servi à s’installer, elle vit sobrement au rythme de la nature. Son livre commence par la vulgarisation scientifique puis elle apporte des solutions pour lutter contre l’effondrement actuel du vivant qui est pour elle plus vaste que le seul réchauffement climatique. Elle est épaulée par des chercheurs reconnus. Hélène veut recréer de la biodiversité ce qui permettra d’apporter des changements indispensables pour une vie meilleure.
Un ouvrage qu’elle a voulu grand public, susceptible d’intéresser tous les âges et tous les milieux socio-culturels. Ce livre est merveilleusement bien illustré, très pédagogique, très clair. Chaque chapitre donne envie de se plonger dans la lecture. “Quel monde voulons-nous ? où allons - nous ?” Chaque thématique se termine par un questionnement.
Toutes mes très sincères félicitations à Hélène pour son engagement qui servira aux générations futures. Mais soyons tous vigilants, car nous sommes malheureusement au bord de la “disparition du vivant”.
Cependant restons optimistes.
Un livre à consulter régulièrement. La disparition du vivant et moi d’
Hélène Grosbois - Illustrations : Amandine Lesay
Éditions Marabout - 2024 - 182 p. - 25 €
Jacky Morelle, présidente de la commission culture (24/01/2025)
Passagère du silence de Fabienne Verdier
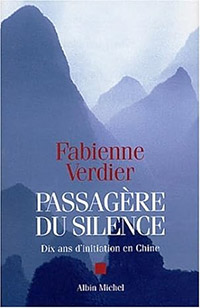 Ce
livre n’est pas facile à lire pour le profane. Il lui faut
désespérément s’accrocher pour entrer dans cette quête de
l’auteure qui, au long de presque dix années d’exil, va
découvrir l’art de la peinture et surtout la calligraphie
chinoises. S’accrocher au vocabulaire qui lui est presque
totalement étranger. S’accrocher à la philosophie que
découvre l’"étrangère" elle-même et peu à peu lui permet
d’entrer dans la mentalité de tous ces "Anciens", oubliés,
martyrisés au cours des étapes d’évolution de la Chine, mais
qui sont envers et contre tout la base de l’art chinois.
Mais une fois déterminé à suivre Fabienne Verdier dans cette
aventure extraordinaire, il éprouve un véritable bonheur à
en découvrir à son tour les arcanes, même si, probablement,
beaucoup de choses lui échappent !
Ce
livre n’est pas facile à lire pour le profane. Il lui faut
désespérément s’accrocher pour entrer dans cette quête de
l’auteure qui, au long de presque dix années d’exil, va
découvrir l’art de la peinture et surtout la calligraphie
chinoises. S’accrocher au vocabulaire qui lui est presque
totalement étranger. S’accrocher à la philosophie que
découvre l’"étrangère" elle-même et peu à peu lui permet
d’entrer dans la mentalité de tous ces "Anciens", oubliés,
martyrisés au cours des étapes d’évolution de la Chine, mais
qui sont envers et contre tout la base de l’art chinois.
Mais une fois déterminé à suivre Fabienne Verdier dans cette
aventure extraordinaire, il éprouve un véritable bonheur à
en découvrir à son tour les arcanes, même si, probablement,
beaucoup de choses lui échappent !
Cette aventure commence au début des années 80, période où
se pratique en France, un enseignement en dehors de tout
apprentissage des maîtres et hors de tout vocabulaire
signifiant. Déçue, Fabienne Verdier a quitté son école et
pris l’habitude de se rendre au musée d’Histoire naturelle
où elle dessine tout ce qui lui semble intéressant. Elle
poursuit seule ses études, se présente aux examens au bout
de trois ans, alors que le cursus est habituellement de cinq
ans. "Lors de l’examen", écrit-elle, "les
autres élèves, confiants en leur art, se sont lancés dans
des abstractions lyriques ou des sujets morbides. Il en
résultait une facture implicite, une violence surfaite. Ils
se croyaient les échos des Expressionnistes allemands qui
avaient souffert et exprimaient leur misère. Eux n’étaient
le plus souvent que des petits-bourgeois de province
désireux de se faire plaisir. Il eût fallu transcender ces
angoisses ou ces visions pour parvenir à un langage plus
subtil".
Elle est brillamment reçue bien qu’ayant mené de front
études et travail afin d’être indépendante. Elle commence à
apprendre le chinois : elle se voit offrir une bourse
d’études pour Paris, mais elle la refuse parce qu’elle veut
aller étudier en Chine. L’administration finit par accepter
et "organise" son voyage et son séjour là-bas.
Et c’est ainsi qu’à vingt ans, parlant à peine la langue,
elle quitte ses parents, ses amis pour se retrouver épuisée,
après un voyage qui a duré des semaines où elle a été
brinqueballée de mauvais trains en aéroports sordides, à
l’institut des Beaux-Arts de Chongqing, dans la province du
Sichuan, où aucun Occidental n’a mis les pieds depuis 1949,
et où, pour la handicaper encore plus, les autochtones ne
parlent qu’un dialecte local. Désormais, il lui faut
accepter la stricte discipline de cette école régie par le
parti communiste. A la demande de quelque ministère, elle
obtient de vivre dans une chambre au lieu de "vivre à
huit dans un dortoir, avec des lits superposés". "La
fenêtre est munie de barreaux" ; on lui apporte "un
petit lit muni d’une paillasse ; une vieille femme ratatinée
et édentée" va "s’occuper d’elle" (elle apprendra plus
tard qu’en fait, son rôle est de l’espionner) et lui
apportera de l’eau, car il n’y pas d’eau à l’institut, sauf
"une pièce où chaque matin, les deux mille étudiants de
l’institut vont remplir leurs thermos". Au réfectoire,
ils font la queue avec leur gamelle et leurs couverts
numérotés. Ils mangent en marchant (car ils ont peu de
temps) jusqu’à "une table sale, collante de graisse, des
moustiques écrasés sur les murs, des crachats par terre, le
sol pas balayé, une odeur de cramé à vous donner des
haut-le-coeur"… Pendant longtemps, elle va trouver que
la nourriture n’est pas mauvaise jusqu’à ce qu'elle apprenne
qu’elle bénéficie d’un passe-droit et qu’elle exige aussitôt
de manger avec les autres étudiants.
Dès le premier cours, elle reçoit "une gifle magistrale",
devant tout le gratin de l’institut venu voir cette élève
qui "est sortie première de son école". Hélas, il
s'avère "qu’elle est incapable de "peindre un arbre"
avec des bâtons d’encre et une pierre à encre". En
fait, elle déclare qu’il lui faut tout son attirail
habituel, ce qui fait rire tout son auditoire. Il lui faut
donc "tout recommencer à zéro". Même si
l’enseignement qui lui est distribué n’est pas du tout ce
qu’elle espérait.
Elle ne peut pas apprendre l’art pictural des anciens et
l’art calligraphique, dévastés par la Révolution culturelle.
L’ambiance est pénible, les étudiants détestant d’emblée l’"étrangère"
! "J’étais éprouvée, sonnée par ce premier choc avec la
Chine. Je me demandais si j’allais rester. La réalité ne
coïncidait pas avec l’idée que je me faisais de ce pays et
de ce que je venais y trouver. Et pendant des années il en
fut ainsi".
Elle finira par tomber malade, à cause de la nourriture
mauvaise et rare, de l'eau sans doute polluée, puisqu'elle
contractera une hépatite, etc. Mais elle est déterminée à
affronter tous les obstacles, y compris la promiscuité, la
misère et la saleté ambiantes, la maladie et la surveillance
incessante dont elle va faire l’objet pendant tout son
séjour ! Bien que n’ayant pour vivre que la maigre bourse de
l’Etat français, elle se paie d’audace, contacte et devient
l’élève de très grands artistes vivant comme des miséreux,
méprisés et marginalisés par le régime. Malgré les risques
d’être pris et envoyés dans des fermes de l’arrière-pays,
ils accepteront de l’initier aux secrets d’un enseignement
remontant à la Chine la plus ancienne.
Elle va, pendant des années, suivre l’enseignement des
professeurs de l’institut, "où l’on n’enseignait ni la
poésie, ni l’esthétique, ni la calligraphie dont les traits
ont été repris dans la peinture traditionnelle. Cette grande
peinture avait été rejetée, on avait détruit bon nombre
d’œuvres pendant la Révolution culturelle […]. Il fallait
s’inspirer de l’art folklorique, par exemple des papiers
découpés… choisir pour thème la vie dans les campagnes ou
les vieilles légendes. Evidemment, l’art ne devait exprimer
aucune contestation, même voilée".
Avec acharnement, elle tente d'entrer dans l'esprit des
Chinois. Elle constate par exemple qu'au cours d’histoire de
l’art, "le professeur avait vécu très jeune la
Révolution culturelle, y avait cru et avait voulu détruire
tout ce qui se rapportait au passé. Maintenant que la Chine
semblait s’ouvrir, il redécouvrait la richesse de la
philosophie chinoise". La jeune femme suit donc les
tentatives des élèves chinois, de percer l'esprit occidental
au moyen de projections de diapositives qui leur permettent
de découvrir les œuvres. Mais elle se pose nombre de
questions sur leur démarche : "Comment comprendre la
peinture occidentale, depuis les fresques romanes jusqu’à
Delacroix, sans connaître le christianisme, la mythologie
grecque et romaine, l’humanisme de la Renaissance, etc.?".
Elle sollicite de son professeur une initiation à la pensée
chinoise, aux philosophies taoïstes, au confucianisme, au
bouddhisme. Elle remarque combien il est difficile de
changer les esprits : "A chaque fois, je le mettais dans
une situation embarrassante car il ne comprenait plus
pourquoi il avait participé à cette folie"... Comme
apparemment, cet homme encore jeune veut changer, il tente
de s'ouvrir aux questionnements de son élève.
Mais comment peut-elle comprendre le changement en train de
s'opérer en Chine ? Elle observe beaucoup les jeunes
étudiants qui l'entourent et constate qu'"une nouvelle
école commençait à naître grâce à quelques audacieux et
aussi au directeur de l'université qui permettait leurs
innovations 'décadentes'". Elle se sent proche de ce
groupe, qui avait "décidé de prendre pour modèle Cézanne
et Picasso […]. Van Gogh provoquait des ravages : l'artiste
fou et maudit correspondait à leur idéal". Quelques-uns
ont "découvert aussi l’influence de Gauguin, Derain,
Matisse, Chagall"… Elle constate avec plaisir qu'"une
démarche authentique et sincère animait ces tableaux nés
dans les banlieues industrielles de Chongqing".
D'autres interrogations la taraudent, relatives à l'éthique
de cette ouverture à l'Occident : "Il était
extraordinaire de voir ces jeunes s’inspirer entièrement
d’une culture étrangère. Mais qu’avaient-ils eu droit de
conserver de la leur ? On leur avait refusé cet héritage
sous prétexte qu’il n’était qu’un ramassis de vieilleries.
Reprendre ainsi à son compte une culture qu’ils ne
connaissaient que par des reproductions restait un processus
totalement artificiel chez certains mais, chez d’autres,
s’était intériorisé de manière surprenante". Ce qui
l'entraîne vers une conclusion : Qu'elle veut, en fait, "parcourir
le chemin exactement inverse du leur" ; et que "si
une étrangère était capable de maîtriser l’art du pinceau
traditionnel chinois comme ces artistes chinois avaient
maîtrisé la peinture à l’huile, elle pourrait créer une
peinture nouvelle".
Il lui a fallu des mois pour trouver et convaincre de
l'accepter pour élève un vieil érudit, Huang Yuan dont des "révolutionnaires"
ont mutilé la main simplement parce qu'il était fidèle aux
traditions du passé. Ayant vu quelques œuvres qu'elle a
accomplies à son intention et déposées chaque matin pendant
six mois devant sa porte, il constate qu'en cinquante ans il
n'a jamais "rencontré un élève aussi doué" ;
qu'elle possède "un niveau de compréhension étonnant
pour une Occidentale" ; qu'elle "possède une
intelligence du cœur qui (la) porte vers les meilleurs"
et qu'elle "mérite d'être enseignée selon les règles".
Mais il la prévient d'emblée, qu'il lui faudra dix ans pour
pénétrer un tant soit peu la pensée chinoise, et qu'avant
d'aborder la calligraphie, elle devra effectuer un stage
chez un maître graveur de sceaux.
Son initiation à la calligraphie lui semble de prime abord
dérisoire : elle doit commencer par le trait horizontal
qu'elle doit répéter quotidiennement pendant des mois,
jusqu'à ce que le trait atteigne la perfection. Ensuite, le
maître l'initie "au trait-point qui doit représenter un
caillou dévalant une montagne, prêt à éclater ; au trait
oblique qui ressemble à une corne de rhinocéros ; au trait
vertical qui est comme un clou rouillé ; au trait
oblique-appuyé qui est comme la vague qui se fracasse sur le
sable et se termine en roulement de tambour" !
Rationnelle, elle désire connaître le sens de ces signes,
cherche dans des dictionnaires, ce qui met son professeur en
colère. Il l'incite à suivre son principe : "Révèle
l'élan, le dynamisme, la ligne de force. Mais je ne veux pas
de prouesse technique. Tu dois arriver à une complète
maîtrise de l'encre et du pinceau pour insuffler de la vie
au trait". [….]. Cet entraînement va durer plusieurs
saisons jusqu'à ce que n'en pouvant plus, elle explose, à la
grande joie de son maître qui danse sur place, "avec une
jouissance incompréhensible". "Je suis bien vieux",
dit-il, "à présent, je n'y suis jamais arrivé. Mais toi,
petite imbécile que tu es, tu y parviendras… le fait que tu
reconnaisses que tu es ignare devant l'éternel, c'est
l'attitude que je désirais que tu aies pour approcher la
peinture".
Son initiation à la calligraphie durera trois ans. A la
suite de quoi, elle en viendra au paysage. Là encore,
l'initiation est parfois fastidieuse, même si pour
l'encourager, le maître peint avec elle des paysages à
quatre mains : "Le beau en peinture, selon
l’enseignement des vieux maîtres", lui dit-il, "n’est
pas le beau tel qu’on l’entend en Occident. Le beau, en
peinture chinoise, c’est le trait animé par la vie, quand il
atteint le sublime du naturel. Le laid ne signifie pas la
laideur d’un sujet qui, au contraire, peut être intéressante
: si elle est authentique, elle nourrit un tableau. Le laid
c’est le labeur du trait, du travail trop bien exécuté,
léché, l’artisanat. Les manifestations de la folie, de
l’étrange, du bizarre, du naïf, de l’enfantin sont
troublantes car elles existent dans ce qui nous entoure.
Elles possèdent une personnalité et une saveur propres, une
intelligence. Ce sont des humeurs qu’il faut développer.
Toi, en tant que peintre, tu dois saisir ces subtilités.
Mais l’adresse, l’habileté, la dextérité qui, en Occident,
sont souvent considérées comme une qualité, sont un
désastre, car on passe à côté de l'essentiel. La maladresse
et le raté sont bien plus vivants".
Un peu d'humour fait du bien dans ce récit. Fabienne Verdier
raconte comment, ayant voulu travailler pour s'offrir des
livres, elle va passer plusieurs mois à réaliser, pour un
journal, des illustrations sur le thème des jeux chinois, et
lorsqu'elle se précipite à la poste récolter ses gains elle
touche "L'équivalent de sept francs et six centimes"
!
Dès le début de son séjour, elle a souffert de la solitude,
au point que, pour être moins seule, elle suit le conseil de
son vieux maître et s'achète un oiseau qui parle, ce qui lui
vaudra quelques anecdotes cocasses quand il répondra à sa
place ! Mais elle souffre de l'agressivité de certains
étudiants, à cause de son statut à part. Pourtant, elle
participe aux surprises-parties de l'université, accepte les
invitations de la télévision au jour de l'an pour
s'apercevoir qu'elle a été "manipulée par la propagande
sans (s')en rendre compte"; les invitations à la Fête
des Morts ; l'invitation à la crémation d'un mort, spectacle
en Chine psychologiquement terrible. Malgré tout, elle s'est
liée avec quelques camarades, et comme elle n'a pas le droit
de sortir le soir, ils l'entraînent à faire le mur, et
l'emmènent à quelque fête à Chongqing éloignée de plusieurs
kilomètres, avec obligation d'être rentrés à l'aube ! Chaque
événement, rompant la monotonie, est conté comme un petit
miracle, telle la rencontre avec un photographe connu qui "cherche
un bel arbre" ou avec Joris Ivens qui, lui, en chaise
roulante, cherche le vent, quête dont il fera plus tard un
film. Elle s'attarde avec l'équipe du Festival d'Avignon
recherchant des bateliers ; déteste la venue inopinée de son
père ; parle de l'arrivée inattendue d'un colis
qui s'évère contenir un gros œuf en chocolat envoyé par sa
tante Yvonne, brisé lors du voyage, ce qui la remplit
d'émotion au point qu'elle éclate en sanglots. Elle raconte
aussi sa maladie où elle est hospitalisée et, où, revenue
dans sa chambre, la vieille femme l'oblige à boire une
potion traditionnelle, dont l'ordonnance est "d'une
poésie folle : une vraie potion de sorcière à l'odeur
insoutenable ! "carapaces (de tortue) aux neuf
côtes revenues à feu doux, poudres à broyer ou faire sauter
à l'alcool". Elle narre avec beaucoup d'émotion sa
relation amoureuse interdite avec un étudiant chinois, les
cachoteries auxquelles ils doivent se livrer pour se voir.
Mais, la fiancée revenue, l'histoire d'amour prend fin
jusqu'au jour où se trouvant nez à nez à Pékin où elle s'est
rendue, il lui déclarera en voyant ses peintures : "C'est
toi qui vas réussir. Je t'aimais mais je n'avais pas le
choix. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi !".
Bien d'autres épisodes suivent, tantôt drôles, tantôt
tragiques.
Un très long chapitre est consacré à ses voyages : Elle
insiste sur les moyens rudimentaires dont les étudiants
disposent lors de ces voyages où ils partent "en car
avec, sous le bras, siège pliant numéroté, carton à dessins
aux couleurs de l'Armée populaire, sans oublier un pot de
conserve en verre dont (ils devront se servir) au long du
périple, de gourde ou de thermos". Mais elle s'extasie
sur la beauté des paysages, l'accueil chaleureux des paysans
qui les invitent à manger ; se récrie sur la saleté immonde
des toilettes et ses avatars lorsqu'elle est obligée de s'en
servir ; s'étonne de ce qu'elle a vu dans la Ville des
Dinosaures ; narre ses incursions dans la ville de Chengdu
tellement différente et plus évoluée que Chongqing ; fait
part de son admiration pour le temple taoïste de la Chèvre
de Cuivre et partage ses visites souvent animées dans les
ateliers des artistes chinois ; parle pour la première fois
d'un vieillard qui garde dans une gourde un grillon dressé ;
s'attriste parce que lors du voyage vers la Montagne de la
Pureté, son maître retrouve son fils "affecté comme
ouvrier dans une usine sordide" ; ironise à l'idée que
le temple orné de peintures grotesques et érotiques permet
aux vieux moines de conserver "leur vigueur sexuelle
grâce aux antiques recettes transmises, entre autres par
(l'ouvrage intitulé) le Classique de la fille sombre".
Elle consacre plusieurs longs paragraphes à son voyage au
Tibet, zone absolument interdite, où elle est "aux anges
devant ces paysages magiques, ces étendues d'infini".
Ils lui font "mieux comprendre à quel point le ciel
régit l'ordonnance du monde" comme le lui a enseigné
son vieux maître. Elle s'attarde sur la misère régnante, le
sort des femmes, l'absence de toutes les nécessités de la
vie, l'horreur du passage chez le peuple des Yi, zone
rigoureusement interdite aux étrangers, où elle doit voyager
cachée sur le toit du car, sous les cages à oies d'où elle
émergera couverte de fientes, mais où personne ne la
dénonce. "Le territoire était dangereux depuis l'arrivée
de l'Armée et des Gardes rouges, car les Yi comme les
Tibétains, restaient des irréductibles". Finalement, ce
voyage tournera au cauchemar lorsque, en un geste
inconscient, elle touche la très longue natte d'un homme, ce
qui est un crime ; se retrouve en prison, enfermée dans une
cellule, considérée comme une espionne. Il faudra
l'intervention du directeur de l'institut auprès de gens
haut placés pour la libérer, mais le voyage sera écourté de
la moitié au grand dam de son professeur et des autres
élèves. Elle pense sans cesse aux parole d'un Yi "complètement
saoul qui (lui) a lancé avec violence : Rentrez
chez vous et racontez ce qui nous arrive, ce qui se passe
ici. Il n'y a plus de culture yi, on ne peut plus penser yi,
on n'a plus le droit d'être yi". Une excursion
inattendue vers le plus ancien temple de Chine permettra à
son vieux maître de faire à Fabienne Verdier ses
recommandations, lui développant les principes du Bouddhisme
et du Taoïsme, se demandant ce "que donnent nos textes
traduits en langues occidentales. Vos concepts sont issus de
la philosophie grecque et du christianisme. Le Tao n’est ni
votre Dieu, ni l’Etre, ni un principe qui régit l’univers,
mais peut-être un peu de tout cela. […] Mais, de toute
façon, méfie-toi des livres : on y croit trop par le seul
fait qu’ils sont écrits. Apprends notre pensée surtout par
la pratique de la peinture. Tu iras beaucoup plus loin ainsi".
Le temps a passé. L'étudiante a vieilli, a gagné en
maturité. Ses deux dernières années sont plus aisées, car
elle perçoit une bourse américaine obtenue grâce à sa tante
ethnologue. Elle peut visiter les hauts lieux de la culture
chinoise signalés par ses vieux maîtres. Elle visite
Shanghai, ville qu'elle aime beaucoup. Et c'est là qu'elle
va vivre dans une famille d'éleveurs de grillons, insecte
pour lequel elle se passionnera ! Là aussi qu'elle sera
fascinée par la "robe de son hôtesse, épouse du très
grand calligraphe Li Tianma. Une couleur ocre sur l’endroit,
noire sur l’envers, usée par le temps, d’une légèreté
extrême, douce au toucher, appelée "Toile de soie aux nuages
parfumés". A chaque lavage, cette soie fait apparaître
de nouveau dessins. Elle dure toute une vie. La couleur
ocre est obtenue grâce à une teinture à base de sédiments de
lits de rivières. Enthousiasmée, Fabienne Verdier se fait
conduire à la boutique qui vend encore cette teinture
devenue rare et l'emploiera comme un moyen de transformer la
surface trop blanche du papier sur lequel elle peint. Par
contre, elle va de déception en déception, après chaque
visite à de vieux érudits locaux.
Son doctorat en poche, obtenu dans l'ambiance terrifiante
d'une révolte qui se terminera sur la place de Tian'anmen à
Pékin, elle approfondit ses connaissances. Mais la politique
resserre les cordons de l'apparente liberté qui régnait.
Considérée comme une ennemie du peuple, fabienne Verdier se
voit contrainte de quitter la Chine dans les meilleurs
délais. Tout de même, le vernissage de son exposition où se
presse la foule, est un succès. Par prudence, à cause des
risques encourus aux douanes, ses amis lui conseillent de
brûler tous ses documents, ses archives… Elle part donc "sans
valises, avec uniquement des cartons fermés par des
ficelles" (que les douaniers ouvriront tous) "contenant des
peintures, du matériel de peintre, quelques objets
personnels". Son départ, entourée de ses amis, du
directeur de l'institut, de ses professeurs et leurs
épouses, est un déchirement. De Hong Kong, elle apprendra
les horreurs qui se déroulent en Chine où règne la pire
répression.
Revenue en France dans un état pitoyable, elle est soutenue
par son oncle et sa tante. Mais bientôt le deuil de leur
mort dans un accident s'ajoutera à la tristesse car son
retour en France est un nouvel exil ! Elle se souvient
d'avoir rencontré l'ambassadeur de France, le contacte ainsi
que, sans grand espoir, les responsables des Affaires
étrangères. Et un jour, elle apprend du Quay d'Orsay : "Vous
êtes nommée à Pékin. Vous partez dans trois semaines…".
Les diplomates comptent sur elle pour redresser, sans
budget, les relations internationales au plus bas depuis
Tienan men. "De l'état de clocharde du Sichuan vivant au
milieu des Chinois, je passai", dit-elle, "à une
existence de diplomate avec appartement de fonction,
cuisinier, et une employée de maison que j'appelais
affectueusement 'Tante' Xu". Elle s'efforcera de faire
au mieux son nouveau métier, jusqu'à ce que son vieux maître
vienne se fâcher pour qu'elle quitte ce poste et devienne ce
qu'elle a toujours été : une peintre.
Le livre se termine sur le nouveau départ de Fabienne
Verdier pour la France, son mariage, sa vie d'artiste, ses
questionnements, les déserts de pierre de l'Ardèche, ses
mots qui racontent tout cela à la fois : "Ce sentiment
d'union entre l'univers et sa beauté, je tente de le
transmettre par mes toiles […] J’ai compris que l’extase,
qu’elle se crie ou se taise, n’est pas un don du Ciel qu’on
attend les bras croisés, mais qu’elle se conquiert, se
façonne et que l’intelligence y a aussi sa part. Pendant dix
ans, le vieux Huang m’a obligée à transcrire la couleur au
travers d’une gamme monochrome, le plus souvent noire, à
l’aide du lavis et de l’encre de Chine. Exercice difficile
pour retrouver, dans l’intensité des noirs, la richesse
subtile des lumières de l’univers. La saveur neutre du lavis
nourrit l’être essentiel. Cette beauté dont on ne se lasse
pas n’est pas celle du paraître. Sa sobriété, son humilité
créent une présence intense dans son effacement.
Depuis vingt ans, je cherche, j'invente des fonds de
tableaux susceptibles d'accueillir avec grâce la pensée
poétique des coups de pinceau…".
Ainsi ce livre déroule-t-il une expérience unique d'où sont
nés un vrai récit d’aventures et une œuvre personnelle
fascinante, qui met en relief la difficulté pour une
Occidentale, bien que d'une intelligence et d'une
sensibilité exceptionnelles, à saisir l'esprit de la Chine
ancestrale, avec la conscience que celle-ci ait été
quasiment détruite ! Ce livre autobiographique pose le
problème de la rencontre d'un individu avec une autre
culture. L'auteure y conjugue l'obstination malgré le
dépaysement, la rigueur dans le travail, la patience et
l'humilité, les réflexions sur l'art. Bref, tout ce qui se
rapporte au cœur et à l'esprit. Ce qui en fait un ouvrage
exceptionnel. A lire absolument.
Jeanine Rivais (31/10/2023)
Passagère du silence - Fabienne Verdier - Editions Le
livre de poche - 312 p. - 8,70 €